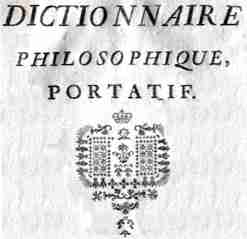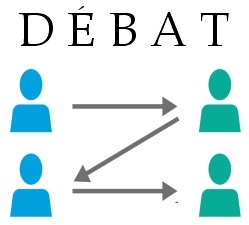Wir geben hier den Artikel Athée, Athéisme (Atheist, Atheismus) aus der ersten Ausgabe des Philosophischen Wörterbuchs von 1764 in französischer Sprache wieder.
Autrefois quiconque avait un secret dans un art courait risque de passer pour un sorcier; toute nouvelle secte était accusée d’égorger des enfants dans ses mystères; et tout philosophe qui s’écartait du jargon de l’école était accusé d’athéisme par les fanatiques et par les fripons, et condamné par les sots.
Anaxagore ose-t-il prétendre que le soleil n’est pas conduit par Apollon monté sur un quadrige; on l’appelle athée, et il est contraint de fuir.
Aristote est accusé d’athéisme par un prêtre; et ne pouvant faire punir son accusateur, il se retire à Chalcis. Mais la mort de Socrate est ce que l’histoire de la Grèce a de plus odieux.
Aristophane (cet homme que les commentateurs admirent parce qu’il était Grec, ne songeant pas que Socrate était Grec aussi), Aristophane fut le premier qui accoutuma les Athéniens à regarder Socrate comme un athée.
Ce poète comique, qui n’est ni comique ni poète, n’aurait pas été admis parmi nous à donner ses farces à la foire Saint-Laurent; il me paraît beaucoup plus bas et plus méprisable que Plutarque ne le dépeint. Voici ce que le sage Plutarque dit de ce farceur: „Le langage d’Aristophane sent son misérable charlatan: ce sont les pointes les plus basses et les plus dégoûtantes; il n’est pas même plaisant pour le peuple, et il est insupportable aux gens de jugement et d’honneur; on ne peut souffrir son arrogance, et les gens de bien détestent sa malignité.“
C’est donc là, pour le dire en passant, le Tabarin que Mme Dacier, admiratrice de Socrate, ose admirer: voilà l’homme qui prépara de loin le poison dont des juges infâmes firent périr l’homme le plus vertueux de à Grèce.
Les tanneurs, les cordonniers et les couturières d’Athènes applaudirent à une farce dans laquelle on représentait Socrate élevé en l’air dans un panier, annonçant qu’il n’y avait point de Dieu, et se vantant d’avoir volé un manteau en enseignant la philosophie. Un peuple entier, dont le mauvais gouvernement autorisait de si infâmes licences, méritait bien ce qui lui est arrivé, de devenir l’esclave des Romains, et de l’être aujourd’hui des Turcs: Les Russes, que la Grèce aurait autrefois appelés barbares, et qui la protègent aujourd’hui, n’auraient ni empoisonné Socrate ni condamné à mort Alcibiade.
Franchissons tout l’espace des temps entre la république romaine et nous. Les Romains, bien plus sages que les Grecs, n’ont jamais persécuté aucun philosophe pour ses opinions. Il n’en est pas ainsi chez les peuples barbares qui ont succédé à l’empire romain. Dès que l’empereur Frédéric II a des querelles avec les papes, on l’accuse d’être athée, et d’être l’auteur du livre des Trois imposteurs, conjointement avec son chancelier De Vineis.
Notre grand chancelier de L’Hospital se déclare-t-il contre les persécutions, on l’accuse aussitôt d’athéisme, Homo doctus, sed verus atheus. Un jésuite autant au-dessous d’Aristophane qu’Aristophane est au-dessous d’Homère, un malheureux dont le nom est devenu ridicule parmi les fanatiques mêmes, le jésuite Garasse, en un mot, trouve partout des athéistes; c’est ainsi qu’il nomme tous ceux contre lesquels il se déchaîne. Il appelle Théodore de Bèze athéiste; c’est lui qui a induit le public en erreur sur Vanini.
La fin malheureuse de Vanini ne nous émeut point d’indignation et de pitié comme celle de Socrate, parce que Vanini n’était qu’un pédant étranger sans mérite; mais enfin Vanini n’était point athée comme on l’a prétendu; il était précisément tout le contraire.
C’était un pauvre prêtre napolitain, prédicateur et théologien de son métier, disputeur à outrance sur les quiddités et sur les universaux et utrum chimera bombinans in vacuo possit comedere secundas intentiones. Mais d’ailleurs, il n’y avait en lui veine qui tendît à l’athéisme. Sa notion de Dieu est de la théologie la plus saine et la plus approuvée. „Dieu est son principe et sa fin, père de l’un et de l’autre, et n’ayant besoin ni de l’un ni de l’autre; éternel sans être dans le temps, présent partout sans être en aucun lieu. Il n’y a pour lui ni passé ni futur; il est partout et hors de tout, gouvernant tout, et ayant tout créé, immuable, infini sans parties; son pouvoir est sa volonté, etc.“ Cela n’est pas bien philosophique, mais cela est de la théologie la plus approuvée.
Vanini se piquait de renouveler ce beau sentiment de Platon embrassé par Averroès, que Dieu avait créé une chaîne d’êtres depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dont le dernier chaînon est attaché à son trône éternel; idée, à la vérité, plus sublime que vraie, mais qui est aussi éloignée de l’athéisme que l’être du néant.
Il voyagea pour faire fortune et pour disputer; mais malheureusement la dispute est le chemin opposé à la fortune; on se fait autant d’ennemis irréconciliables qu’on trouve de savants ou de pédants contre lesquels on argumente. Il n’y eut point d’autre source du malheur de Vanini; sa chaleur et sa grossièreté dans la dispute lui valurent la haine de quelques théologiens; et ayant eu une querelle avec un nommé Francon, ou Franconi, ce Francon, ami de ses ennemis, ne manqua pas de l’accuser d’être athée enseignant l’athéisme.
Ce Francon ou Franconi, aidé de quelques témoins, eut la barbarie de soutenir à la confrontation ce qu’il avait avancé. Vanini sur la sellette, interrogé sur ce qu’il pensait de l’existence de Dieu, répondit qu’il adorait avec l’Église un Dieu en trois personnes. Ayant pris à terre une paille: « Il suffit de ce fétu, dit-il, pour prouver qu’il y a un créateur. » Alors il prononça un très beau discours sur la végétation et le mouvement, et sur la nécessité d’un Être suprême, sans lequel il n’y aurait ni mouvement ni végétation.
Le président Grammont, qui était alors à Toulouse, rapporte ce discours dans son Histoire de France, aujourd’hui si oubliée; et ce même Grammont, par un préjugé inconcevable, prétend que Vanini disait tout cela par vanité, ou par crainte, plutôt que par une persuasion intérieure.
Sur quoi peut être fondé ce jugement téméraire et atroce du président Grammont? Il est évident que sur la réponse de Vanini on devait l’absoudre de l’accusation d’athéisme. Mais qu’arriva-t-il? ce malheureux prêtre étranger se mêlait aussi de médecine: on trouva un gros crapaud vivant, qu’il conservait chez lui dans un vase plein d’eau; on ne manqua pas de l’accuser d’être sorcier. On soutint que ce crapaud était le dieu qu’il adorait; on donna un sens impie à plusieurs passages de ses livres, ce qui est très aisé et très commun, en prenant des objections pour les réponses, en interprétant avec malignité quelque phrase louche, en empoisonnant une expression innocente. Enfin la faction qui l’opprimait arracha des juges l’arrêt qui condamna ce malheureux à la mort.
Pour justifier cette mort, il fallait bien accuser cet infortuné de ce qu’il y avait de plus affreux. Le minime et très minime Mersenne a poussé la démence jusqu’à imprimer que Vanini était parti de Naples avec douze de ses apôtres pour aller convertir toutes les nations à l’athéisme. Quelle pitié! comment un pauvre prêtre aurait-il pu avoir douze hommes à ses gages? comment aurait-il pu persuader douze Napolitains de voyager à grands frais pour répandre partout cette doctrine révoltante au péril de leur vie? Un roi serait-il assez puissant pour payer douze prédicateurs d’athéisme? Personne, avant le P. Mersenne, n’avait avancé une si énorme absurdité. Mais après lui on l’a répétée, on en a infecté les journaux, les dictionnaires historiques; et le monde, qui aime l’extraordinaire, a cru cette fable sans examen.
Bayle lui-même, dans ses Pensées diverses, parle de Vanini comme d’un athée: il se sert de cet exemple pour appuyer son paradoxe qu’une société d’athées peut subsister; il assure que Vanini était un homme de moeurs très réglées, et qu’il fut le martyr de son opinion philosophique. Il se trompe également sur ces deux points Le prêtre Vanini nous apprend dans ses Dialogues, faits à l’imitation d’Érasme, qu’il avait eu une maîtresse nommée Isabelle. Il était libre dans ses écrits comme dans sa conduite; mais il n’était point athée.
Un siècle après sa mort, le savant La Croze, et celui qui a pris le nom de Philalète, ont voulu le justifier; mais, comme personne ne s’intéresse à la mémoire d’un malheureux Napolitain, très mauvais auteur, presque personne ne lit ces apologies.
Le jésuite Hardouin, plus savant que Garasse, et non moins téméraire, accuse d’athéisme, dans son livre intitulé Athei detecti, les Descartes, les Arnauld, les Pascal, les Nicole, les Malebranche: heureusement ils n’ont pas eu le sort de Vanini.
De tous ces faits, je passe à la question de morale agitée par Bayle, savoir, si une société d’athées pourrait subsister? Remarquons d’abord sur cet article, quelle est l’énorme contradiction des hommes dans la dispute: ceux qui se sont élevés contre l’opinion de Bayle avec le plus d’emportement. Ceux qui lui ont nié avec le plus d’injures la possibilité d’une société d’athées, ont soutenu depuis avec la même intrépidité que l’athéisme est la religion du gouvernement de la Chine.
Ils se sont assurément bien trompés sur le gouvernement chinois; ils n’avaient qu’à lire les édits des empereurs de ce vaste pays, ils auraient vu que ces édits sont des sermons, et que partout il y est parlé de l’Être suprême, gouverneur, vengeur et rémunérateur.
Mais en même temps ils ne se sont pas moins trompés sur l’impossibilité d’une société d’athées; et je ne sais comment M. Bayle a pu oublier un exemple frappant qui aurait pu rendre sa cause victorieuse.
En quoi une société d’athées paraît-elle impossible? C’est qu’on juge que des hommes qui n’auraient pas de frein ne pourraient jamais vivre ensemble; que les lois ne peuvent rien contre les crimes secrets; qu’il faut un Dieu vengeur qui punisse dans ce monde-ci ou dans l’autre les méchants échappés à la justice humaine.
Les lois de Moïse, il est vrai, n’enseignaient point une vie à venir, ne menaçaient point de châtiments après la mort, n’enseignaient point aux premiers Juifs l’immortalité de l’âme; mais les Juifs, loin d’être athées, loin de croire se soustraire à la vengeance divine, étaient les plus religieux de tous les hommes. Non seulement ils croyaient l’existence d’un Dieu éternel, mais ils le croyaient toujours présent parmi eux; ils tremblaient d’être punis dans eux-mêmes, dans leurs femmes, dans leurs enfants, dans leur postérité, jusqu’à la quatrième génération: ce frein était très puissant.
Mais, chez les gentils, plusieurs sectes n’avaient aucun frein les sceptiques doutaient de tout; les académiciens suspendaient leur jugement sur tout; les épicuriens étaient persuadés que la Divinité ne pouvait se mêler des affaires des hommes, et, dans le fond, ils n’admettaient aucune divinité. Ils étaient convaincus que l’âme n’est point une substance, mais une faculté qui naît et qui périt avec le corps; par conséquent ils n’avaient aucun joug que celui de la morale et de l’honneur. Les sénateurs et les chevaliers romains étaient de véritables athées, car les dieux n’existaient pas pour des hommes qui ne craignaient ni n’espéraient rien d’eux. Le sénat romain était donc réellement une assemblée d’athées du temps de César et de Cicéron.
Ce grand orateur, dans sa harangue pour Cluentius, dit à tout le sénat assemblé: Quel mal lui fait la mort? nous rejetons toutes les fables ineptes des enfers: qu’est-ce donc que la mort lui a ôté? rien que le sentiment des douleurs.
César, l’ami de Catilina, voulant sauver la vie de son ami contre ce même Cicéron, ne lui objecte-t-il pas que ce n’est point punir un criminel que de le faire mourir, que la mort n’est rien, que c’est seulement la fin de nos maux, que c’est un moment plus heureux que fatal? Cicéron et tout le sénat ne se rendent-ils pas à ces raisons? Les vainqueurs et les législateurs de l’univers connu formaient donc visiblement une société d’hommes qui ne craignaient rien des dieux, qui étaient de véritables athées.
Bayle examine ensuite si l’idolâtrie est plus dangereuse que l’athéisme; si c’est un crime plus grand de ne point croire à la Divinité que d’avoir d’elle des opinions indignes: il est en cela du sentiment de Plutarque; il croit qu’il vaut mieux n’avoir nulle opinion qu’une mauvaise opinion; mais, n’en déplaise à Plutarque, il est évident qu’il valait infiniment mieux pour les Grecs de craindre Cérès, Neptune et Jupiter, que de ne rien craindre du tout. Il est clair que la sainteté des serments est nécessaire, et qu’on doit se fier davantage à ceux qui pensent qu’un faux serment sera puni, qu’à ceux qui pensent qu’ils peuvent faire un faux serment avec impunité. Il est indubitable que, dans une ville policée, il est infiniment plus utile d’avoir une religion, même mauvaise, que de n’en avoir point du tout.
Il paraît donc que Bayle devait plutôt examiner quel est le plus dangereux, du fanatisme, ou de l’athéisme. Le fanatisme est certainement mille fois plus funeste; car l’athéisme n’inspire point de passion sanguinaire, mais le fanatisme en inspire; l’athéisme ne s’oppose pas aux crimes, mais le fanatisme les fait commettre. Supposons, avec l’auteur du Commentarium rerum Gallicarum, que le chancelier de L’Hospital fût athée; il n’a fait que de sages lois, et n’a conseillé que la modération et la concorde: les fanatiques commirent les massacres de la Saint-Barthélemy. Hobbes passa pour un athée; il mena une vie tranquille et innocente: les fanatiques de son temps inondèrent de sang l’Angleterre, l’Écosse, et l’Irlande. Spinosa était non seulement athée, mais il enseigna l’athéisme: ce ne fut pas lui assurément qui eut part à l’assassinat juridique de Barneveldt; ce ne fut pas lui qui déchira les deux frères de Wit en morceaux, et qui les mangea sur le gril.
Les athées sont pour la plupart des savants hardis et égarés qui raisonnent mal, et qui, ne pouvant comprendre la création, l’origine du mal, et d’autres difficultés, ont recours à l’hypothèse de l’éternité des choses et de la nécessité.
Les ambitieux, les voluptueux, n’ont guère le temps de raisonner et d’embrasser un mauvais système; ils ont autre chose à faire qu’à comparer Lucrèce avec Socrate. C’est ainsi que vont les choses parmi nous.
Il n’en était pas ainsi du sénat de Rome, qui était presque tout composé d’athées de théorie et de pratique, c’est-à-dire qui ne croyaient ni à la Providence ni à une vie future; ce sénat était une assemblée de philosophes, de voluptueux et d’ambitieux, tous très dangereux, et qui perdirent la république. L’épicuréisme subsista sous les empereurs: les athées du sénat avaient été des factieux dans les temps de Sylla et de César; ils furent sous Auguste et Tibère des athées esclaves.
Je ne voudrais pas avoir affaire à un prince athée, qui trouverait son intérêt à me faire piler dans un mortier: je suis bien sûr que je serais pilé. Je ne voudrais pas, si j’étais souverain, avoir affaire à des courtisans athées, dont l’intérêt serait de m’empoisonner: il me faudrait prendre au hasard du contre-poison tous les jours. Il est donc absolument nécessaire pour les princes et pour les peuples, que l’idée d’un Être suprême, créateur, gouverneur, rémunérateur et vengeur, soit profondément gravée dans les esprits.
Il y a des peuples athées, dit Bayle dans ses Pensées sur les comètes. Les Cafres, les Hottentots, les Topinambous, et beaucoup d’autres petites nations, n’ont point de Dieu: ils ne le nient ni ne l’affirment; ils n’en ont jamais entendu parler. Dites-leur qu’il y en a un, ils le croiront aisément; dites-leur que tout se fait par la nature des choses, ils vous croiront de même. Prétendre qu’ils sont athées est la même imputation que si l’on disait qu’ils sont anticartésiens; ils ne sont ni pour ni contre Descartes. Ce sont de vrais enfants; un enfant n’est ni athée ni déiste, il n’est rien.
Quelle conclusion tirerons-nous de ceci? Que l’athéisme est un monstre très pernicieux dans ceux qui gouvernent; qu’il l’est aussi dans les gens de cabinet, quoique leur vie soit innocente, parce que de leur cabinet ils peuvent percer jusqu’à ceux qui sont en place; que, s’il n’est pas si funeste que le fanatisme, il est presque toujours fatal à la vertu. Ajoutons surtout qu’il y a moins d’athées aujourd’hui que jamais, depuis que les philosophes ont reconnu qu’il n’y a aucun être végétant sans germe, aucun germe sans dessein, etc., et que le blé ne vient point de pourriture.
Des géomètres non philosophes ont rejeté les causes finales, mais les vrais philosophes les admettent; et, comme l’a dit un auteur connu, un catéchiste annonce Dieu aux enfants, et Newton le démontre aux sages.